OETH 2026 : Tout savoir sur la fin de l’écrêtement

L’année 2025 marque un véritable tournant pour les entreprises de plus de 20 salariés en équivalent temps plein (ETP) dans la gestion de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Depuis 1987, cette obligation impose aux employeurs d’avoir dans leur effectif au moins 6 % de salariés en situation de handicap. En cas de non-respect de ce quota, une contribution est due à l’Urssaf.
La réforme de la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », entrée en vigueur le 1er janvier 2020, a provoqué une hausse brutale de la contribution OETH (Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés) pour de nombreuses entreprises. Afin de limiter l’impact financier de cette réforme, un dispositif transitoire appelé écrêtement a été mis en place entre 2020 et 2024. Ce mécanisme avait pour objectif d’atténuer progressivement la charge liée à l’augmentation des contributions.
Mais depuis le 1er janvier 2025, ce dispositif a pris fin. Les entreprises vont donc en ressentir directement les effets lors de leur déclaration d’avril 2026. Pour ne pas subir une augmentation non anticipée, il est essentiel d’agir dès maintenant en structurant sa stratégie d’inclusion.
I. Qu’est ce que l’OETH?
L’OETH, c’est quoi?
L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) a été instaurée par la loi de 1987, renforcée depuis par différentes réformes. Concrètement, toute entreprise d’au moins 20 ETP doit employer 6 % de salariés reconnus travailleurs handicapés. Si ce quota n’est pas atteint, l’employeur est tenu de verser une contribution annuelle à l’Urssaf.
Cette contribution est reversée à l’AGEFIPH et vise à financer des politiques publiques en faveur de l’inclusion. Elle s’applique à toutes les entreprises, qu’elles soient privées ou publiques, avec des modalités adaptées à leur statut.
Qui est concerné par l’OETH ?
Toutes les organisations d’au moins 20 ETP sont concernées, qu’elles soient des sociétés commerciales, des associations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). L’obligation peut être remplie par l’emploi direct de personnes en situation de handicap, que ce soit sous CDI, CDD, contrats d’alternance ou même via l’accueil de stagiaires et de périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP).
Il est donc important de comprendre que l’OETH ne repose pas uniquement sur le recrutement classique : plusieurs leviers existent pour remplir cette obligation, notamment le maintien en emploi.
Comment se calcule le taux d’emploi OETH ?
Les entreprises privées et les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) de 20 salariés et plus ont l’obligation d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés.
L’assujettissement à l’OETH est calculé à partir de l’effectif moyen annuel (EMA), déterminé et notifié par l’Urssaf. Depuis la déclaration 2024 (au titre de l’année 2023), l’Urssaf consolide les données DSN et intègre les blocs de régularisation pour fiabiliser le calcul.
Les différents effectifs pris en compte
L’Urssaf calcule plusieurs effectifs moyens annuels :
- EMA BOETH : effectif des bénéficiaires de l’OETH employés par l’entreprise,
- EMA ECAP : effectif des salariés occupant des emplois nécessitant des conditions d’aptitude particulières,
- EMA OETH : effectif d’assujettissement servant de base au calcul de l’obligation.
À cela s’ajoutent les travailleurs handicapés externes (intérim, groupement d’employeurs, associations intermédiaires, agences de mannequins).
L’obligation est appréciée au niveau de l’entreprise dans son ensemble, tous établissements confondus.
Calcul du nombre de travailleurs handicapés à employer
L’Urssaf applique le taux légal de 6 % à l’EMA OETH. Le résultat est arrondi à l’entier inférieur.
Exemple :
- EMA OETH = 33,07 → 33,07 × 6 % = 1,98 → obligation = 1 bénéficiaire.
- EMA OETH = 34,56 → 34,56 × 6 % = 2,07 → obligation = 2 bénéficiaires.
Cas particuliers
- Proratisation : si un salarié obtient la RQTH en cours d’année, il est comptabilisé au prorata des jours concernés.
Exemple : un salarié reconnu travailleur handicapé le 12/06 est comptabilisé pour 0,56 sur l’année (203/365 jours).
- Salariés handicapés de 50 ans et plus : chaque bénéficiaire compte pour 1,5 au lieu de 1 (majoration appliquée directement par l’Urssaf).
- Multiples statuts : un même salarié relevant de plusieurs catégories de bénéficiaires ne peut être compté qu’une fois. En cas de justificatifs multiples, c’est le statut de durée la plus longue qui est retenu.
Bon à savoir
Depuis 2020, la déclaration OETH est intégrée à la DSN mensuelle, ce qui permet à l’Urssaf de réaliser directement le calcul et d’appeler la contribution éventuelle.
II. L’écrêtement, c’est quoi exactement ?
Définition de l’écrêtement
L’écrêtement est un dispositif de plafonnement temporaire destiné à limiter l’augmentation brutale de la contribution OETH suite à la réforme de 2018 et d’éviter ainsi un effet couperet.
Pourquoi l’écrêtement a été mis en place en 2020 ?
Ce mécanisme a été introduit en 2020 pour accompagner les entreprises dans la transition vers la nouvelle formule de calcul de la contribution OETH. Il s’agissait d’une mesure transitoire, visant à donner du temps aux employeurs pour adapter leur stratégie d’inclusion sans être confrontés immédiatement à des charges trop élevées.
III. Janvier 2025 : la fin du dispositif d’écrêtement
La déclaration OETH d’avril 2026, portant sur l’année civile 2025, sera la première sans aucun plafonnement. Les entreprises doivent donc s’attendre à ce que la totalité de la contribution soit calculée sans amortisseur.
Pourquoi l’écrêtement est-il supprimé ?
Dès son lancement, l’écrêtement n’était pas destiné à durer. Le législateur considérait ce mécanisme comme une simple période d’adaptation, le temps que les entreprises structurent leur politique handicap. Sa suppression reflète la volonté des pouvoirs publics de pousser les organisations à mettre en place des actions durables plutôt que de s’appuyer sur une mesure financière adoucissante.
Frise chronologique de l’écrêtement
5 septembre 2018
- Réforme « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui impacte le calcul de la contribution OETH.
1er janvier 2020
- Entrée en application de la réforme de l’OETH : l’obligation s’applique désormais au niveau de l’entreprise et non plus par établissement.
- Toutes les sociétés de 20 salariés et plus sont concernées.
- Début des mesures transitoires avec le dispositif d’écrêtement et un lissage progressif (réduction de 80 % à 50 % des hausses).
31 décembre 2024
- Fin de la période transitoire.
- Disparition du dispositif d’écrêtement et des réductions progressives.
A partir du 1er janvier 2025
- Contribution calculée sans écrêtement.
Les conséquences directes de la suppression de l’écrêtement
Avec la fin de l’écrêtement, la contribution OETH est désormais calculée sans aucun mécanisme d’atténuation. Concrètement, le montant dû par les entreprises repose sur deux paramètres clés :
- l’effectif annuel moyen de l’année 2025,
- le taux d’emploi effectif de travailleurs handicapés dans l’organisation.
Là où l’écrêtement limitait jusqu’ici les hausses excessives, chaque variation aura désormais un impact direct et immédiat sur la contribution. Cela transforme l’OETH en un véritable indicateur de gestion sociale et financière, que les entreprises ne peuvent plus reléguer au second plan.
En d’autres termes, il n’existe plus de “zone tampon” : toute évolution structurelle ou organisationnelle se traduit mécaniquement dans le montant appelé par l’Urssaf.
Quels sont les profils d’entreprises les plus exposés ?
Toutes les entreprises de plus de 20 ETP sont concernées, mais certaines typologies sont davantage exposées au risque d’augmentation brutale.
Les entreprises multi-établissements
Les entreprises multi-établissements figurent parmi les plus vulnérables, notamment lorsqu’elles n’ont pas harmonisé leurs pratiques entre sites et qu’il faut coordonner divers acteurs (RH, managers, référents handicap, CSE, etc). Dans ce cas, l’absence de politique handicap commune peut créer des disparités entre les sites, et accentuer l’écart entre les obligations légales et leur mise en pratique réelle.
Les startups et les scale-ups
Les startups, scale-ups et réseaux en forte croissance représentent un autre profil sensible. Leur dynamique d’embauches rapides accroît mécaniquement leur effectif de référence, ce qui rend le respect du quota de 6 % plus difficile si les recrutements inclusifs et l’accompagnement des salariés ne suivent pas.
Les structures qui ont sous-estimé les évolutions depuis 2020
Certaines structures ont tout simplement sous-estimé la portée des évolutions réglementaires depuis 2020, et découvrent aujourd’hui la disparition de l’écrêtement comme une réalité budgétaire lourde de conséquences.
Comment mesurer l’impact financier dès maintenant ?
La fin de l’écrêtement peut générer un surcoût important. Pour l’anticiper, il est essentiel d’évaluer son impact financier et d’engager rapidement les actions correctives.
Voici comment mesurer l’impact financier de la suppression de l’écrêtement :
Réaliser une simulation du montant de contribution 2025 sans écrêtement
La première étape consiste à simuler le montant de la contribution 2025 sans écrêtement, en utilisant l’effectif et le taux d’emploi actuels. Cet exercice de projection offre une vision claire de l’impact financier et permet de sensibiliser les directions générales et financières au sujet.
Identifier les leviers d’action prioritaires
Ensuite, il s’agit d’identifier les leviers d’action prioritaires. Certains leviers permettent d’agir immédiatement sur la contribution, tandis que d’autres relèvent d’une démarche plus structurelle :
A court terme avec effet immédiat sur la contribution :
- Utiliser les dépenses déductibles (plafonnées à 10% de la contribution) :
- mise en place de programmes de sensibilisation pour lever les freins internes,
- formation des managers pour favoriser l’intégration,
- Utiliser le recours à la sous-traitance inclusive via les ESAT et entreprises adaptées (30% du coût de main d’oeuvre est déductible de la contribution).
À moyen / long terme (impact durable) :
- S’assurer de la prise en compte du handicap dans son organisation :
- former un ou des référents handicap/santé au travail
- au-delà des actions ponctuelles de sensibilisation ou de participation à des évènements, communiquer en interne sur les engagements et les actions menées
- relier l’inclusion du handicap aux actions de prévention ou en lien avec la QVCT
- s’assurer du suivi et de l’accompagnement des salariés bénéficiaires selon leur besoin
Cela favorise le recrutement de travailleurs handicapés, leur fidélisation et par conséquent permet de réduire de façon pérenne la contribution.
Instaurer un suivi mensuel du taux d’emploi
Enfin, l’anticipation repose sur un pilotage continu. Mettre en place un suivi mensuel ou trimestriel du taux d’emploi OETH permet d’aligner la stratégie RH avec les objectifs réglementaires. Les entreprises qui adoptent une logique de monitoring plutôt que de simple réaction en fin d’année pourront ajuster leur trajectoire en temps réel et éviter une contribution trop lourde en 2026.
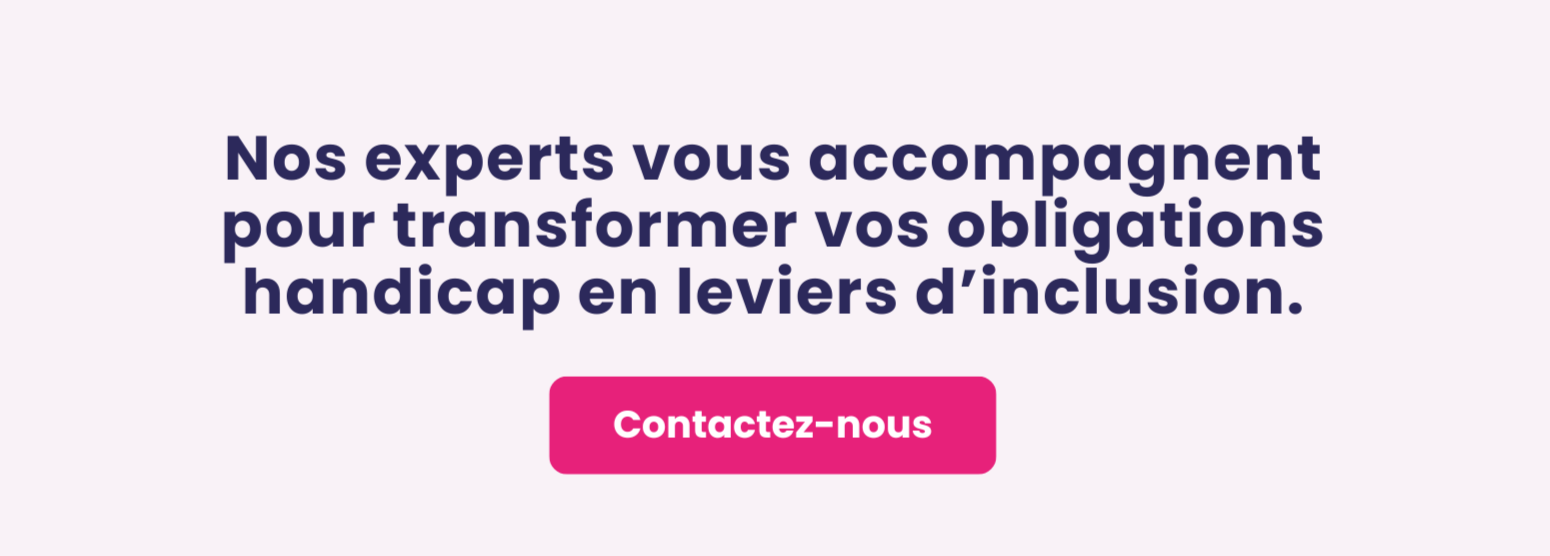
IV. Comment anticiper la fin de l’écrêtement et préparer la DOETH 2026 ?
La disparition de l’écrêtement oblige les entreprises à agir dès 2025 pour limiter l’impact sur leur DOETH d’avril 2026. Plusieurs pistes existent :
Valoriser le handicap déjà présent au sein de l’organisation.
Beaucoup de salariés concernés ne se déclarent pas, souvent par méconnaissance ou par appréhension. Mettre en place des actions de sensibilisation et des dispositifs permettant de mieux prendre en compte le handicap invisible contribue à mieux reconnaître ces situations, à améliorer l’inclusion en interne et ainsi à faire progresser le taux d’emploi.
Recruter et fidéliser des collaborateurs en situation de handicap
Le recrutement direct reste le levier le plus fréquemment évoqué pour améliorer son taux d’emploi OETH. Il peut prendre plusieurs formes : CDI, CDD, alternance ou encore stages. Ces dispositifs offrent une souplesse d’intégration et permettent aux entreprises d’attirer des profils variés, du jeune diplômé au collaborateur expérimenté. Encore faut-il que les candidats ou nouveaux embauchés se déclarent auprès de leur employeur.
Mais recruter ne suffit pas : il est surtout essentiel de fidéliser les talents. Cela passe par un cadre ouvert au dialogue et un accompagnement adapté, y compris :
- des aménagements de poste adaptés (organisation du travail, équipements spécifiques, accessibilité des locaux),
- une formation des managers et équipes pour lever les freins et favoriser un climat inclusif,
- des perspectives de carrière réelles (évolution interne, mobilité, accès à la formation continue).
L’objectif est d’éviter le turn-over et de transformer chaque embauche en une relation de long terme, bénéfique à la fois pour l’entreprise et le salarié.
Développer des partenariats avec des ESAT et entreprises adaptées
Le recours à la sous-traitance inclusive via les ESAT (Établissements et Services d’Aide par le Travail) et les entreprises adaptées constitue une autre voie stratégique pour répondre à l’OETH.
Ces partenariats permettent aux entreprises de :
- externaliser certaines activités (impression, restauration, nettoyage, services administratifs, logistique, etc.),
- bénéficier de prestations de qualité tout en contribuant directement à l’emploi de personnes en situation de handicap,
- diversifier leurs actions en complément du recrutement interne.
En pratique, ces collaborations doivent être pensées comme de véritables relations de partenariat et non comme de simples achats de prestations. Travailler main dans la main avec les ESAT et entreprises adaptées peut générer de la valeur sur le long terme, en renforçant la politique RSE de l’organisation et en valorisant son engagement sociétal auprès des collaborateurs, clients et partenaires.
S’appuyer sur audits et conseils spécialisés pour bâtir une stratégie sur mesure
La réglementation autour de l’OETH est complexe, et son impact varie fortement selon la taille de l’entreprise, son secteur d’activité et sa répartition géographique. Pour éviter les erreurs de calcul ou les actions dispersées, il est souvent utile de recourir à un regard extérieur et expert.
Un audit spécialisé permet de :
- analyser finement la situation de l’entreprise (effectifs, taux d’emploi, montant de la contribution à venir),
- identifier les écarts entre obligations légales et pratiques actuelles,
- mesurer l’impact financier des évolutions réglementaires,
- cartographier les actions déjà mises en place et celles qui restent à engager.
À partir de ce diagnostic, des prestations de conseil apportent une feuille de route claire et adaptée : choix des leviers les plus efficaces (accompagnement des collaborateurs, recrutement, sensibilisation, partenariats inclusifs…), mise en place d’outils de pilotage, accompagnement des directions RH et financières dans le suivi des indicateurs.
👉 La mission de Pidiem est d’accompagner les entreprises dans la construction de leur politique handicap. Grâce à son approche sur-mesure, l’équipe aide à inscrire le handicap comme un véritable levier d’inclusion et de performance durable afin de mieux anticiper les évolutions réglementaires et optimiser les contributions OETH.
La fin de l’écrêtement représente un vrai tournant pour l’OETH. Désormais, les entreprises paieront l’intégralité de leur contribution si elles n’atteignent pas le quota de 6 %. Mais au-delà de l’aspect financier, c’est aussi l’opportunité de développer une culture plus inclusive, dans une logique gagnant-gagnant au bénéfice des salariés et de la performance de l’entreprise.
FAQ – Ce que les entreprises se demandent
Qu’est-ce que l’écrêtement OETH ?
Un dispositif temporaire de plafonnement des hausses de contribution, actif entre 2020 et 2024.
Pourquoi l’écrêtement disparaît-il ?
Parce qu’il s’agissait d’une mesure transitoire, le temps pour les entreprises de s’adapter aux nouvelles règles.
Comment se calcule la contribution OETH ?
La contribution OETH se calcule en fonction de la différence entre le nombre de bénéficiaires théorique correspondant aux 6 %, et le nombre réel de travailleurs handicapés employés. Concrètement, on la calcule selon la formule suivante :
Contribution = coefficient × taux horaire du SMIC × nombre de BOETH manquants.
Exemple de calcul de la contribution OETH
- Effectif total (ETP) : 200 salariés
- Taux légal à respecter : 6 % → bénéficiaires attendus = 200 × 6 % = 12 BOETH
- Bénéficiaires réellement employés : 6
- Nombre de BOETH manquants : 12 – 6 = 6
- Taux horaire du SMIC 2025 : 11, 88€
- Coefficient (entreprises de 20 à 749 salariés) : 400 × (taux horaire du SMIC)
→ Calcul du coefficient : 400 × 11,65 € = 4 660 €
→ Contribution : 4 660 € × 6 = 27 960 €
⚡️ Dans cet exemple, l’entreprise devrait donc verser 27 960 € de contribution à l’Agefiph si aucune action n’est mise en place pour compenser.
Que faire pour réduire durablement la contribution OETH ?
Informer et accompagner les salariés sur la prise en compte du handicap et de la santé au travail. Recruter en montrant son ouverture et sa bienveillance, sensibiliser, développer des partenariats inclusifs. Toutes ces actions permettent de lever les craintes et permettent de faire émerger des situations de handicap invisible.
Quelles sont les sanctions si une entreprise ne respecte pas l’OETH ?
Il n’y a pas de sanction : une contribution financière est due à l’Urssaf qui la reverse à l’AGEFIPH pour financer l’insertion des travailleurs handicapés. Cette contribution peut rapidement représenter un coût significatif si aucune action n’est engagée (1 500 x smic horaire par bénéficiaire manquant).
